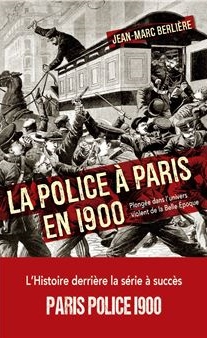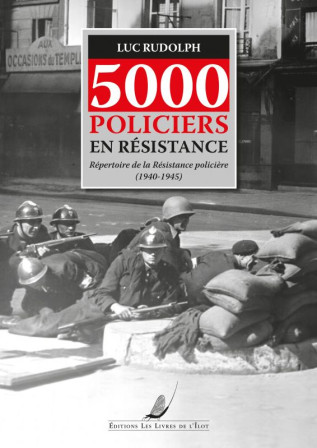 5000 policiers en Résistance - Répertoire de la Résistance policière (1940-1945)
5000 policiers en Résistance - Répertoire de la Résistance policière (1940-1945)
par Luc Rudolph, Editions "Les Livres de l'Ilôt", 2025, 1760 pages
Avec ce monumental ouvrage, le directeur honoraire de la police nationale Luc Rudolph livre aux lecteurs le résultat de dix-sept années d'intenses travaux de recherches menés dans le but de répertorier tous les policiers entrés en Résistance sous l'Occupation nazie, en métropole comme outre-mer.
Lui qui s'est intéressé à ces policiers Résistants dès 2008 - alors que jusque-là les historiens en général de même que l'institution policière elle-même ne prêtaient guère attention à ces personnages à la trajectoire souvent tragique, toujours rebelle - n'a cessé d'explorer tous les fonds d'archives existants (du SHD de Vincennes aux AN, aux AD, aux ANOMer, comme au DAVCC de Caen, au Musée de la Résistance de Toulouse et à bien d'autres sources, notamment des archives privées et des associations d'anciens combattants et déportés).
Il a pu ainsi recenser 5000 policiers engagés dans la Résistance et nous fournit pour chacun d'entre-eux une précieuse notice biographique. On découvre ainsi aussi bien le proto-résistant Louis Lebon, co-créateur du réseau Le Coq Gaullois dès mi-1940, qu'Edmond Dubent, fondateur de L'Honneur de la Police en 1942 ou encore le commissaire Achille Peretti, créateur du fameux réseau Ajax à la mi-1943, mais aussi Jean Philippe, le commissaire Juste parmi les Nations qui a dit "Non!" à Pétain ou bien Solange Allard, travaillant à Poitiers pour le réseau Mousquetaire.
L'ouvrage (que Luc Rudolph dédie à ses parents résistants) est vraiment une formidable et solide mine d'informations et de réflexion. Outre les notices précitées sur les policiers Résistants et leurs réseaux, une présentation générale de la période est proposée et apparaît des plus utiles (calendrier des évènements, souveraineté, collaboration, poids et moyens de l'Occupant, traque des Juifs...). Une incontournable oeuvre de référence.
=====================
.
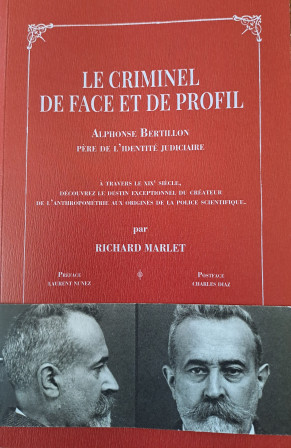
Le criminel de face et de profil - Alphonse Bertillon père de l'Identité Judiciaire
par Richard Marlet, préface du préfet de police Laurent Nuñez et postface de Charles Diaz, Paris, AFITT Editions, 2025, 165 pages.
Voilà une biographie comme on les aime : claire et concise, solide dans ses sources et précise dans ses explications. C'est un régal de lecture que nous offre Richard Marlet avec cet ouvrage consacré à la vie et à l'oeuvre fondatrice d'Alphonse Bertillon (1853-1914), l'inventeur non pas seulement du système d'anthropométrie judiciaire destiné à identifier les récidivistes par diverses mensurations du corps, mais aussi de la photographie anthropométrique face-profil et du traitement de la scène de crime (photographie, plan des lieux, recueil et conservation des traces et indices...), comme des débuts de l'identification par l'empreinte digitale. Richard Marlet sait de quoi il parle, lui qui bien des décennies après sa création par Bertillon en 1893, a dirigé à son tour dans les années 1990 le service de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, y apportant notamment de remarquables améliorations grâce à l'informatique et à la télématique.
Il nous fait revivre le destin exceptionnel de Bertillon, simple commis aux écritures qui va devenir grâce à ses procédés de criminalistique un personnage connu et reconnu dans le monde entier. L'ouvrage n'a cependant rien d'hagiographique. On découvre un Bertillon visionnaire, opiniâtre, travailleur acharné, mais aussi un homme au sale caractère, péremptoire, et refusant jusqu'à sa mort de reconnaître s'être trompé dans son expertise graphologique qui a accablé à tort le capitaine Dreyfus.
En nous projetant aux origines de la police technique et scientifique française, l'ouvrage nous entraîne de fait dans une France de la Belle Epoque (pas si belle que ça!), avec ses progrès stupéfiants, sa criminalité, ses souffrances et ses inquiétudes. A lire sans hésiter.
=====================
.
BRI, les patrons de l'Antigang se mettent à table
par Simon Riondet et Franck Hériot, Paris, Mareuil Editions, octobre 2024. 183 pages.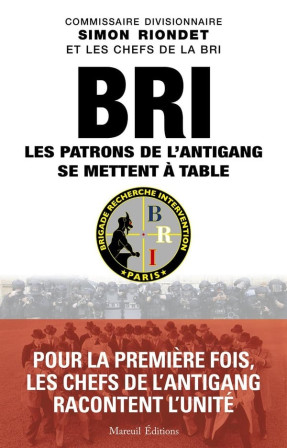
La B.R.I., brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, fête cette année les soixante ans de sa création.
C'est en septembre 1964, que le commissaire principal François Le Mouel, alors chef d'une brigade territoriale parisienne, prend la tête d'une Section de Recherche et d'Intervention, créée à son initiative et avec le soutien du directeur PJ de l'époque, Max Fernet, pour mettre un terme à la vague de vols à main armée (accompagnés bien souvent de prises d'otages) qui déferle sur la capitale et sa banlieue et que les méthodes classiques d'enquête a posteriori ne parviennent pas à juguler. Il s'agit de privilégier le travail de terrain, les surveillances et filatures en particulier, plutôt que l'enquête paperassière, afin de capturer en flagrant délit les équipes de braqueurs.
Très vite, cette unité justifie sa création et devient une brigade centrale autonome du quai des Orfèvres, la B.R.I., que les médias surnomment bientôt "L'Antigang". Avec, aux commandes, des grands patrons tels que Robert Broussard, Claude Cancès ou Jean-Marc Bloch, c'est elle qui durant les années 1970 et 1980 apporte son concours opérationnel à la brigade criminelle de Paris pour lutter contre les affaires d'enlèvement avec demande de rançon qui se multiplient alors et obtenir la libération des otages sains et saufs. Elle encore qui intervient dans la traque des malfaiteurs et des terroristes les plus dangereux, à l'exemple de Christian Jubin ou de Jacques Mesrine comme du "Gang des Postiches". Elle, enfin, qui entre dans l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes en janvier 2015 et au Bataclan en novembre de la même année pour neutraliser les tueurs terroristes et sauver les otages.
C'est sur ce passé que l'actuel chef de la BRI, Simon Riondet, revient dans cet ouvrage avant de laisser la parole à plusieurs grands flics, notamment plusieurs anciens patrons de l'Antigang, dont les récits et les analyses apportent un exceptionnel aperçu sur l'histoire de la Police Judiciaire parisienne de ces 60 dernières années. Leurs témoignages éclairent, passionnent, bouleversent et questionnent sur l'époque contemporaine, sa criminalité et sa police.
.
=====================
Policiers et polices dans l'Indochine française 1864-1955
par Jean-Paul Faivre, préface de Jean-Marc Berlière, Paris, Memoring Editions, janvier 2024. 534 pages.
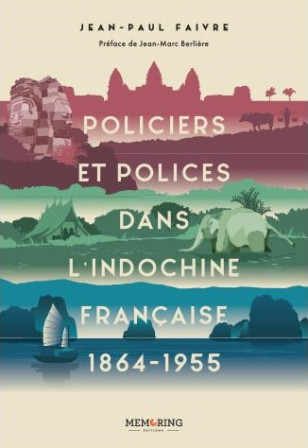
Déjà auteur d'un convaincant ouvrage intitulé Itinéraire d'un Officier de la Coloniale paru en 2019, le commissaire divisionnaire honoraire Jean-Paul Faivre, infatiguable découvreur du Laos, du Cambodge et du Vietnam, de leur présent comme de leur passé, propose cette fois au lecteur, au terme de sept années d'incessantes recherches, une histoire du monde policier de l'Indochine coloniale, "perle de l'Empire", dont il décrit d'une plume précise, adroite et incisive les structures administratives et leur évolution, les organisations d'ensemble ou particulières, les arcanes du fonctionnement et la variété des pratiques.
Il y ajoute toute une série de portraits de policiers aux parcours révélateurs d'une société d'hier (qui ne manque pas de points communs avec celle d'aujourd'hui...) aux coulisses parfois surprenantes et de services où l'on retrouve les grandes lignes du modèle de la Métropole revu, corrigé, "colonialement adapté" avec ou sans véritable réussite. On ne dira jamais assez combien cet ouvrage
comble un grand vide dans l'histoire de la police de cette période et de la France coloniale. Jean-Paul Faivre nous offre également, cerise sur ce "gâteau" historiographique, de nombreuses illustrations dont beaucoup sont totalement inédites à ce jour.
Laissons pour finir la parole à l'historien Jean-Marc Berlière, qui a préfacé ce livre. Il écrit : "En un mot comme en cent, un livre passionnant, indispensable, une mine d'informations qui manquait terriblement tant à l'histoire du Vietnam qu'à celle de la police ; un travail de bénédictin dont on doit féliciter l'auteur."
Tout est dit, alors bonne lecture à toutes et à tous!!!
=======================
.
Le 36 au temps de Maigret
par Charles Diaz, Paris, Mareuil Editions, juin 2024. 265 pages.
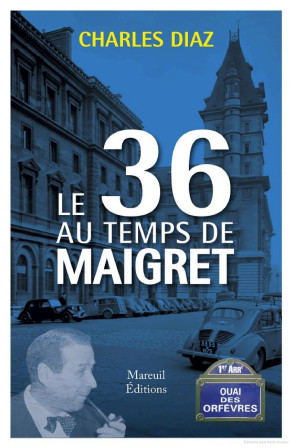 Personnage le plus illustre de la littérature policière française, le commissaire Maigret a rendu célèbre dans le monde entier, à partir des années 1930, l'adresse mythique du 36 quai des Orfèvres, siège de la direction de la police judiciaire de Paris.
Personnage le plus illustre de la littérature policière française, le commissaire Maigret a rendu célèbre dans le monde entier, à partir des années 1930, l'adresse mythique du 36 quai des Orfèvres, siège de la direction de la police judiciaire de Paris.
Dans quelles circonstances l'écrivain belge Georges Simenon, le père de Maigret, a-t-il découvert l'endroit et ses services d'investigation? Pourquoi a-t-il choisi de placer le bureau de son massif personnage au 36? Quels grands flics d'alors lui ont servi de modèles pour donner épaisseur et savoir-faire à son enquêteur de légende? Quelles grandes affaires criminelles ont marqué l'époque? Ce nouvel ouvrage de Charles Diaz, vice-président de la SFHP, répond à ces questions et à bien d'autres concernant les coulisses du 36 quai des Orfèvres à la naissance de Maigret. Il propose en outre au lecteur l'intégralité d'un document exceptionnel et rare : une brochure interne voulue par Xavier Guichard, le directeur de la PJ qui a accueilli Simenon pour la première fois au 36 quai des Orfèvres en 1931.
Ce document détaille l'organisation et le fonctionnement des services de ce temps-là, comme la brigade spéciale (future brigade criminelle),les brigades de voie publique (future brigade de répression du banditisme) ou l'identité judiciaire. D'où la brigade mondaine tient-elle son nom? Quels vêtements porter selon la nature des enquêtes? Quels pièges à éviter durant les filatures? Quel comportement adopter au cours des interrogatoires? Autant de clefs livrées aux hommes (et aux femmes!) du 36 contemporains des premiers pas du célébrissime fumeur de pipe.
Le livre prend un malin plaisir à relever les invraisemblances et les approximations techniques et juridiques disséminées par Georges Simenon dans ses Maigret (mais n'est-ce pas là la liberté d'un auteur de fiction?) et propose également un lexique de l'argot de la P.J. en ces années 1930, un argot que les personnages maigretiens manient à l'occasion.
A découvrir, qu'on soit amateur de polar ou passionné d'histoire, policier ou pas, maigretophile ou pas.
.
.
Alias Cristal 18 : Trente-quatre ans au 36 quai des Orfèvres
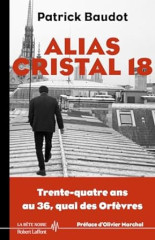 par Patrick Baudot (avec la collaboration de Laurent Chabrun), préface d'Olivier Marchal, Paris, Robert Laffont, collection La Bête Noire, octobre 2023. 273 pages.
par Patrick Baudot (avec la collaboration de Laurent Chabrun), préface d'Olivier Marchal, Paris, Robert Laffont, collection La Bête Noire, octobre 2023. 273 pages.
"Cristal 18", c'était son indicatif radio lorsqu'il était chef de groupe à la brigade criminelle du quai des Orfèvres où il a interpellé, interrogé, enquêté, dirigé des investigations jour et nuit des années 1980 aux années 2010. L'ex-commandant de police Patrick Baudot, avec sa carrure tendance Lino Ventura et sa gouaille à la Philippe Noiret (dixit Olivier Marchal dans sa chaleureuse préface à l'ouvrage), sans parler de ses talents de musicien, est devenu au cours de ces décennies l'une des grandes figures de la Crim'.
Il nous fait revivre dans ce livre illustré de saisissantes photographies à ne pas mettre sous tous les yeux, les enquêtes les plus remarquables qu'il ait eu à traiter, de l'enlèvement de la petite Mélodie Nakachian à l'affaire de Dieuleveult. Cadavres découpés en morceaux, meurtres sans mobile apparent, scènes de crime tenant du Mystère de la Chambre Jaune si cher à Gaston Leroux, rien ne manque pour garder le lecteur en haleine et pénétrer les secrets de l'investigation criminelle version règlements de comptes mafieux, drames familiaux ou déraillements de la sexualité ou de la cupidité, entre autres.
Un ouvrage extrêmement agréable à lire qui est à la fois un solide témoignage sur l'évolution des méthodes de travail des enquêteurs criminels parisiens à la fin du XXe siècle et sur le ressenti d'un homme honnête confronté aux tragédies de l'absurde.
La DST sur le front de la Guerre Froide
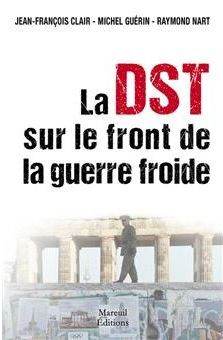
par Jean-François Clair, Michel Guérin et Raymond Nart, Paris, Mareuil Editions, octobre 2022. 300 pages.
Trois grandes pointures du contre-espionnage français, trois anciens hauts fonctionnaires de police qui ont occupé durant la seconde moitié du 20e siècle des postes au plus haut niveau de la DST, la direction de la surveillance du territoire (mère de la DCRI, puis de la DGSI d'aujourd'hui), se sont unis pour nous offrir cet ouvrage à la fois éclairant (et ce n'est pas si simple quand le sujet baigne dans l'ombre et le mystère), rigoureux et captivant.
Revenant sur les origines de la DST et sa création en 1944, nous rappelant les enjeux d'une Guerre Froide qui a opposé pendant des décennies les deux blocs constitués, d'un côté, par l'URSS et ses satellites ; de l'autre, par les Etats-Unis et leurs alliés, nos trois experts relatent avec maestria le combat mené alors, en première ligne, par la DST face au KGB, au GRU et à leurs avatars, de l'après-guerre jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989.
Ils nous parlent d'un temps où règne la désinformation, où les anonymes soldats de la DST travaillent (et meurent parfois...) en silence. Rien ne manque, ni les fines analyses de ces trois grands professionnels du renseignement, ni les anecdotes (parfois savoureuses...), ni un retour sur les échecs, comme sur les succès (on pense ici à la fameuse affaire Farewell sur laquelle revient bien sûr le livre) qui ont marqué cette période de leur indélébile empreinte. A découvrir toutes affaires cessantes.
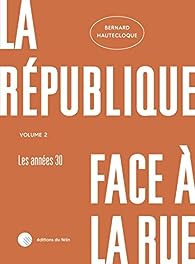 La République face à la rue - Volume 2 - Les années 30
La République face à la rue - Volume 2 - Les années 30
par Bernard Hautecloque, Paris, Paris, Editions Le Félin, mai 2023. 204 pages.
Historien et auteur que l'on ne présente plus à nos visiteurs, Bernard Hautecloque poursuit avec cet ouvrage l'impressionnante série en 7 volumes qu'il a commencé de consacrer à un siècle d'histoire du maintien de l'ordre en France.
Ce deuxième volume nous transporte dans les Années Folles, quand la Troisième République doit faire face à des tensions extrêmes que les difficultés économiques du moment, la montée en puissance d'idéologies malsaines portées par d'inquiétants voisins, tout comme la fragilité des cabinets ministériels qui se succèdent ne résorbent pas, tout au contraire. Avec cet art du récit qui le caractérise, l'auteur décortique le rôle des forces de maintien de l'ordre tout particulièrement durant la manifestation antiparlementaire du 6 février 1934, une manifestation qui tourne à l'émeute place de la Concorde avec le projet de prendre d'assaut la Chambre des Députés, de l'autre côté de la Seine.
La nature des affrontements (dont certains d'une violence inouie), l'organisation et le comportement des forces de l'ordre sont disséqués et analysés page après page, nous faisant revivre avec beaucoup de réussite cette terrible nuit d'hiver où il fallait éviter au pays de basculer dans la dictature ou de sombrer dans la guerre civile.
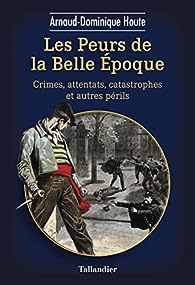 Les Peurs de la Belle-Epoque - Crimes, attentats, catastrophes et autres périls
Les Peurs de la Belle-Epoque - Crimes, attentats, catastrophes et autres périls
par Arnaud-Dominique Houte, Paris, Editions Tallandier, octobre 2022. 331 pages.
Professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, grand spécialiste de la France au XIXe siècle comme de l'histoire des polices et des questions de sécurité, l'auteur nous invite à découvrir les grandes préoccupations de la population française sur une période allant de l'Exposition Universelle de 1889 jusqu'à la mobilisation générale de l'été 1914, une époque de grandes avancées techniques, de prospérité économique (au moins pour certains), de démocratie politique (la Jeune Troisième République commence à s'installer durablement), mais aussi d'épidémies, d'attentats anarchistes, d'accidents spectaculaires, de manifestations durement réprimées. Tout cela dans un climat de tensions sociales, de menaces de guerre et de sentiment d'insécurité exacerbés par une presse populaire à très grand tirage n'agissant jamais sans arrières-pensées politiques.
L'ouvrage brosse un puissant tableau de ces drames et des menaces plus ou moins fantasmées qui parcourent un peuple d'implantation encore largement rurale. Il analyse les questions sécuritaires d'alors (passant en revue des annales criminelles où figurent, entre autres, le poseur de bombes Ravachol, les Apaches de Paris ou la Bande à Bonnot) et met en évidence bien des réactions sociales et politiques, outrancières ou maladroites, inefficaces ou décalées qui ne sont pas sans nous rappeler la sitation d'aujourd'hui.
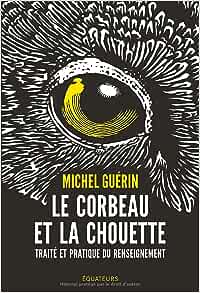 Le Corbeau et la Chouette - Traité et pratique du Renseignement
Le Corbeau et la Chouette - Traité et pratique du Renseignement
par Michel Guérin, Paris, Editions Equateurs, octobre 2022. 218 pages.
Inspecteur général honoraire de la police nationale et ancien grand patron de la direction de la surveillance du territoire où il a fait toute sa carrière, l'auteur nous livre dans ce manuel à la fois théorique, historique et pratique une passionnante et précise étude sur le monde du renseignement. Que recouvre cette activité pratiquée depuis toujours par l'Humanité et par ... les oiseaux? En quoi la matière est-elle différente de l'intelligence économique ou de l'espionnage? Qui sont ces agents si discrets et si professionnels qui pratiquent le renseignement parfois au péril de leur vie et dont l'image largement fantasmée par l'opinion publique oscille - avec l'aide de la littérature, du cinéma et des séries TV - entre mauvaise réputation (les spécialistes du mensonge et des coups tordus...) et sauveurs façon James Bond.
Aux côtés de Michel Guérin qui sait faire partager son incroyable expérience, on découvre l'organisation des services de renseignement comme leur culture de l'espionnage et leurs méthodes qui varient d'un pays à l'autre, de la Russie aux USA, de la Grande-Bretagne à la France ; on pénètre l'art et la philosophie du renseignement ; on imagine la dure réalité du travail de terrain des agents du renseignement et les qualités qu'ils doivent avoir. Entre autres, cette grande force morale qui transparaît dans les portraits de quelques légendaires agents que propose ce livre, un livre qu'on oublie pas de sitôt.
La police à Paris en 1900 - Plongée dans l'univers violent de la Belle Epoque
par Jean-Marc Berlière, Paris, Nouveau Monde Editions, février 2023. 295 pages.
La série à succès "Paris Police 1900" a fait découvrir au grand public la situation de la capitale au tournant du siècle, sur fond d'affaire Dreyfus et de nationalisme exacerbé, avec le fracas d'une criminalité dont la presse populaire d'alors fait ses choux gras, non sans arrières-pensées politiques. Pour nous aider à mieux appréhender et comprendre cette période d'un point de vue historique, il fallait le regard et la plume d'un expert. C'est chose faite avec ce livre que nous propose Jean-Marc Berlière.
Professeur émérite à l'Université de Bourgogne, il a consacré sa thèse de doctorat (1991) à "L'institution et la société policière sous la IIIe République", avant de nous offrir, notamment, une pléthore d'articles et deux ouvrages remarquables sur ladite période ; l'un sur la "Police des Moeurs" (1992- Seuil) ; l'autre sur "le Préfet Lépine : vers la naissance de la police moderne" (1993 - Perrin), ouvrages désormais disponibles en livre de proche. Autant dire que Jean-Marc Berlière était le mieux à même de nous présenter avec clarté et précision, et d'une écriture toujours aussi sûre et alerte, le décor, les coulisses et les agissements de la police et des malfrats qu'elle combat en 1900.
Rien ne manque, ni les débuts difficiles puis surmédiatisés de la police technique sous la houlette de Bertillon, ni les pratiques inquiétantes de la police politique et les agissements glauques de la police des moeurs, ni l'état d'esprit de policiers très majoritairement recrutés chez les anciens militaires, ni les violents affrontements avec les extrêmistes ou avec les Apaches. A cela s'ajoute une galerie de personnages hors du commun, de la courtisane Marguerite Steinheil au préfet Louis Lépine, en passant par l'insupportable Jules Guérin, journaliste et directeur de l'hebdomadaire "L'Antijuif". Un livre à ne pas manquer.
*******************
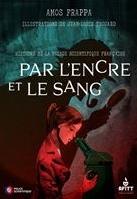 Par l'encre et le sang - Histoire de la police scientifique française
Par l'encre et le sang - Histoire de la police scientifique française
par Amos Frappa, Paris, éditions Afitt, février 2023. 348 pages.
Enseignant lyonnais qui a consacré sa thèse de doctorat d'histoire contemporaine à "Edmond Locard et la police scientifique", Amos Frappa retrace dans cet ouvrage (aux superbes illustrations que l'on doit à Jean-Louis Thouard) les grandes périodes de l'histoire de la police technique et scientifique française, de ses débuts avec le Parisien Bertillon, père de l'anthropométrie judiciaire, et le professeur Locard ouvrant un premier laboratoire de police scientifique sous les combles du palais de Justice de Lyon en 1910, des grandes réussites des premières décennies, puis le grand creux des années 1950-70, ue "traversée du désert" avant que Jacques Genthial ouvre la voie à la police technique et scientifique moderne, avec l'informatisation des empreintes digitales, l'exploitation de l'ADN et le développement de bien des méthodes innovantes de traitement des scènes d'infraction.
D'une écriture habile facilitant ainsi la vulgarisation d'une matière souvent complexe, parfois même hermétique, Amos Frappa nous fait partager les tâtonnements, les avatars, les doutes, les forces et les faiblesses (dont les divisions de ses principaux acteurs) de l'art forensique. Une réussite. A noter, en outre, la très intéressante postface du livre écrite par l'inspecteur général Eric Angelino, actuel chef du service national de police scientifique, un texte qui sert d'excellent trait d'union entre l'histoire des pionniers de la police scientifique et le quotidien de leurs successeurs d'aujourd'hui.
*******************
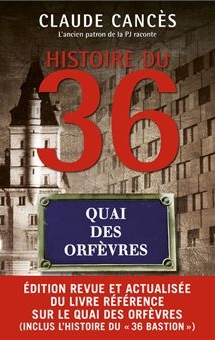 Histoire du 36 Quai des Orfèvres - réédition augmentée et actualisée
Histoire du 36 Quai des Orfèvres - réédition augmentée et actualisée
par Claude Cancès, Paris, Mareuil éditions, février 2023. 535 pages.
L'ancien directeur de la Police Judiciaire de Paris, Claude Cancès revient vers nous avec cette réédition augmentée et actualisée de son livre à succès (plus de 100 000 exemplaires vendus...) relatant les grandes affaires criminelles traitées par les brigades spécialisées et les services d'une direction PJ de la capitale installée durant plus d'un siècle dans l'enceinte du Palais de Justice dans l'Ile de la Cité, au 36 quai des Orfèvres avant de déménager dans le 17e arrondissement au milieu des années 2010, avec pour nouvelle adresse le 36 rue du Bastion.
On lira (ou relira) avec plaisir les récits que Claude Cancès consacre en particulier aux enquêtes qu'il a vécues de près durant les années 1980-1990, notamment comme numéro 2 de la brigade criminelle, comme chef de la brigade antigang et comme directeur, confronté aux attentats sanglants perpétrés par des organisations terroristes internationales, aux braquages en tous genres, aux enlèvements avec demandes de rançon comme aux crimes odieux bouleversant l'opinion publique. Il nous fait découvrir les coulisses de la chute de Madame Claude tout comme la pression extrême mise sur les enquêteurs après la mort accidentelle de Lady Di. Et tant d'autres affaires célèbres, gardant bien souvent leur part de mystère.
Claude Cancès profite de cette nouvelle édition pour nous raconter avec maints détails inédits l'installation de la PJ parisienne dans ses nouveaux locaux modernes du 36 Bastion, et pour nous narrer avec toujours la même précision et la même verve les grandes affaires qui ont marqué les premières années d'activité des enquêtrices et enquêteurs du nouveau 36, avec notamment l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le sinistre parcours du "Grêlé", ce tueur et violeur en série qui a réussi à échapper aux recherches des décennies durant avant de tomber le masque. Une incontournable lecture.
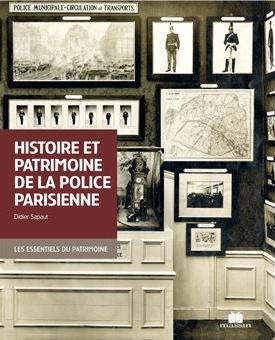 Histoire et patrimoine de la police parisienne
Histoire et patrimoine de la police parisienne
par Didier Sapaut, Paris, Editeur Massin, décembre 2021, 190 pages, grand format.
Historien et documentariste, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et de l'ENA, ancien directeur général de la chaîne "Histoire", Didier Sapaut nous dévoile, avec un indéniable savoir-faire, dans ce livre grandement illustré le patrimoine unique de la police parisienne, au temps des lieutenants généraux de police et depuis la création de la préfecture de police de Paris sous Bonaparte.
Avec lui, on découvre les archives exceptionnelles gérées par la préfecture de police elle-même, tout comme les uniformes, les équipements et les objets du quotidien utilisés à travers les âges par une police chargée aussi bien de la tranquillité et de la salubrité publique que de la lutte contre les escrocs, les voleurs en tous genres et les assassins.
Didier Sapaut accorde dans son ouvrage une place particulière au patrimoine architectural qu'il nous fait découvrir à travers tous les arrondissements parisiens. En nous surprenant bien souvent. Son livre est captivant et nous donne immédiatement envie de retourner dans le quartier Latin pour visiter le musée de la préfecture de police...
*******************
La "mission C", Alger, décembre 1961-juin 1962
par Roger Le Doussal, Paris, Fauves éditions, mai 2020. 560 pages.

La "mission C" (C comme Choc) est le service de police judiciaire qui, de décembre 1961 à juin 1962, va contribuer à la lutte sans merci que le général de Gaulle lance contre l'organisation terroriste OAS, l'organisation de l'Armée secrète qui mène dans le même temps de nombreux attentats contre les institutions françaises et le chef de l’État lui-même.
Restituant l'apocalyptique climat de guerre civile des derniers mois de la souveraineté française en Algérie, ce livre - que l'on doit au directeur honoraire de police Roger Le Doussal, grand spécialiste de la Guerre d'Algérie - éclaire certains sujets qui continuent à faire polémique : La "mission C" a-t-elle pratiqué la torture? Quelle fut la nature de ses rapports avec les barbouzes? Et avec le FLN, le Front de Libération Nationale, ennemi avant le cessez-le-feu du 19 mars 1962 et "allié" ensuite? Pourquoi n'a-t-elle joué aucun rôle dans la recherche des quelque 1800 Européens enlevés par le FLN à partir d'avril 1962, en violation des accords d'Evian?
Roger Le Doussal nous avait livré il y a quelques années (en 2011 pour être précis) un excellent récit autobiographique retraçant ses années de "commissaire de police en Algérie de 1952 à 1956". Ce nouvel ouvrage qui a demandé un formidable travail de recherches est à la fois une mine d'informations inédites sur la période considérée pour les historiens et, pour tous les lecteurs, une exploration incisive du monde policier et de ses pratiques.
Concernant cette période de notre histoire, à découvrir également l'article intitulé "Les policiers tués pendant la guerre d'Algérie. Un silence abyssal", article que l'on doit à Michel Salager et qu'il a publié sur le site de la Société Lyonnaise d'Histoire de la Police.
*******************
Juillet 1893 - Le Mai 68 de la IIIe République
par Bernard Hautecloque, éditions du Félin, Histoire & Sociétés, novembre 2020, 120 pages.
 L'Affaire Dreyfus n'a pas encore éclaté et Sadi-Carnot, le président de la jeune Troisième République, n'a pas encore été assassiné... Nous sommes à l'été 1893.
L'Affaire Dreyfus n'a pas encore éclaté et Sadi-Carnot, le président de la jeune Troisième République, n'a pas encore été assassiné... Nous sommes à l'été 1893.
Les émeutes étudiantes qui vont bientôt bouleverser Paris ont aujourd'hui à peu près totalement disparu des mémoires. Et pourtant... En ce tout début du mois de juillet 1893, à la suite d'une "bavure" policière (la mort d'un homme de 23 ans lors de la dispersion d'une manifestation), la communauté étudiante de la capitale, alors peu nombreuse mais très solidaire, volontiers brutale et frondeuse, s'insurge, érige des barricades en donnant même l'impression pendant plusieurs jours d'arracher à l'autorité de l’État son "fief" du Quartier latin.
Juillet 1893 ne fut pas le seul embrasement estudiantin de la seconde moitié du 19e siècle, loin s'en faut, mais il fut sans doute le plus grave, celui qui impressionne le plus fortement les contemporains. Par bien des aspects, l'évènement n'est pas sans rappeler le bouillonnant mai 68 et d'autres dimensions, d'autres questionnements d'une plus proche actualité. Précipitant l'arrivée en fonction du préfet Louis Lépine, il marque une étape décisive dans l'histoire de la police et du maintien de l'ordre.
Historien et grand spécialiste des affaires criminelles, Bernard Hautecloque est aussi un très bon conteur. Il livre ici au lecteur un récit alerte et passionnant sur ces journées de juillet 1893, en reconstituant avec précision le déroulement des faits, en nous dévoilant leurs coulisses et en nous proposant une analyse qui suscite bien des questions sur l'âge d'or de la Troisième République.
****************
Histoire des polices en France - Des guerres de Religion à nos jours
par Vincent Milliot (sous la direction de), avec les contributions d'Emmanuel Blanchard, Vincent Denis et Arnaud Houte, éditions Belin, février 2020.
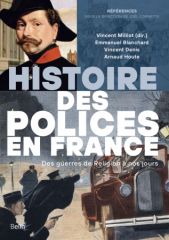 Quatre enseignants universitaires de renom, auteurs d'ouvrages sur l'institution policière comme sur le "Le Métier de Gendarme", ouvrages dont nous avons déjà rendu compte sur ce site, se sont associés pour offrir au lecteur ce livre de référence de 584 pages, richement illustré, qui nous fait vivre l'évolution sur plusieurs siècles des polices en France, leur autonomisation, leur spécialisation, leur professionnalisation, face aux turbulences de l'Histoire, au fracas des crises politiques et sociales, des Jacqueries aux Gilets Jaunes, des révoltes aux révolutions.
Quatre enseignants universitaires de renom, auteurs d'ouvrages sur l'institution policière comme sur le "Le Métier de Gendarme", ouvrages dont nous avons déjà rendu compte sur ce site, se sont associés pour offrir au lecteur ce livre de référence de 584 pages, richement illustré, qui nous fait vivre l'évolution sur plusieurs siècles des polices en France, leur autonomisation, leur spécialisation, leur professionnalisation, face aux turbulences de l'Histoire, au fracas des crises politiques et sociales, des Jacqueries aux Gilets Jaunes, des révoltes aux révolutions.
On y découvre à chaque époque les pratiques, les moyens, les méthodes et la culture des forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité et l'ordre public, qu'il s'agisse de la préfecture de police parisienne, des polices municipales, des polices nationales, ainsi que de la gendarmerie. L'accent est mis sur le rapport entre police et population. Ouvert aux comparaisons comme à l'étude des circulations internationales, ce livre fait la part belle aux échanges avec d'autres polices européennes et, pour la première fois, aux espaces colonisés, en Amérique, en Afrique et en Asie.
Enfin, il propose un "Atelier" qui détaille les sources et leurs usages, parcourt les fronts pionniers de la recherche et rend compte des débats historiographiques les plus actuels.
***************
L'affaire Hazan- La première grande affaire d'enlèvement
par Claude Cancès et Jean-Pierre Birot, Mareuil éditions, 2020, 173 pages.
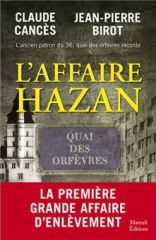 L'ancien patron du quai des Orfèvres Claude Cancès (à qui nous devons déjà plusieurs livres de témoignage des plus passionnants) s'est associé cette fois à son ami Jean-Pierre Birot, une autre grande figure de la PJ parisienne des années 1970-90, pour nous raconter de l'intérieur une affaire criminelle qu'ils ont vécu ensemble de bout en bout, l'enlèvement le 31 décembre 1975 de Louis Hazan, le PDG de la société Phonogram, productrice de grands artistes comme Aznavour, Halliday ou Brassens.
L'ancien patron du quai des Orfèvres Claude Cancès (à qui nous devons déjà plusieurs livres de témoignage des plus passionnants) s'est associé cette fois à son ami Jean-Pierre Birot, une autre grande figure de la PJ parisienne des années 1970-90, pour nous raconter de l'intérieur une affaire criminelle qu'ils ont vécu ensemble de bout en bout, l'enlèvement le 31 décembre 1975 de Louis Hazan, le PDG de la société Phonogram, productrice de grands artistes comme Aznavour, Halliday ou Brassens.
A leurs côtés, dans les locaux de la Crim' ou sur le terrain, nous suivons chaque étape de l'enquête qui va conduire à la libération de l'otage sain et sauf quelques jours plus tard et à l'arrestation des auteurs de ce kidnapping crapuleux et du "cerveau" de ce coup qui passe aux aveux. L'histoire est prenante, le récit précis et les personnages bien mis en relief. On en apprend beaucoup sur les méthodes d'alors et sur des choix décisifs faits par Pierre Ottavioli, le chef de la brigade criminelle qui saura mettre en échec la vague d'enlèvements qu'annonce cette première affaire, au point d'être surnommé "Monsieur anti-rapt" par les journaux, radios et télévisions. Une précieuse contribution à la connaissance de cette page des chroniques criminelles de Paris.
********************
Dictionnaire Fouché
Ouvrage collectif, sous la direction de Julien Sapori, Tours, Nouvelles éditions Sutton, 2019.
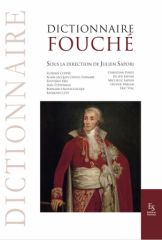 Un véritable évènement à signaler que la parution de ce dictionnaire consacré à Joseph Fouché, l'un de ces personnages de l'histoire de France qui continue de susciter, deux siècles après sa mort (ou presque, il s'est éteint en 1820), toujours autant de controverses et de débats, sur un fond souvent passionné.
Un véritable évènement à signaler que la parution de ce dictionnaire consacré à Joseph Fouché, l'un de ces personnages de l'histoire de France qui continue de susciter, deux siècles après sa mort (ou presque, il s'est éteint en 1820), toujours autant de controverses et de débats, sur un fond souvent passionné.
On doit ce livre d'une grande richesse historiographique à une équipe d'une dizaine d'historiens venus d'horizons très différents (dont Raymond Lévy et Bernard Hauteclocque, deux membres actifs de notre association) pour apporter leur sensibilité et leur contribution d'expert à des travaux placés pendant plusieurs années sous la direction de Julien Sapori, ancien commissaire divisionnaire aujourd'hui à la retraite, et historien grand spécialiste de Fouché (il a été l'auteur en 2007 d'un remarqué "L'exil et la mort de Joseph Fouché", aux éditions Anovi).
Révolutionnaire et "régicide", "mitrailleur de Lyon", inquiétant ministre de la police, mais aussi ministre de l'Intérieur, député de la Corrèze, de Nantes, sénateur d'Aix, comte d'Empire et duc d'Otrante... quel que soit le moment auquel on s'intéresse dans le parcours de Fouché (à propos duquel Louis Madelin, l'un de ses biographes, a écrit que les romanciers lui ont toujours été plus favorables que les historiens), ce moment-là déclenche invariablement le questionnement et éveille une véritable soif d'informations. Cet imposant ouvrage (576 pages) est de ce point de vue une mine d'or. Ses 127 notices (allant du mot "Acteurs" au nom de "Zweig", cet autre biographe d'un si grand talent) nous proposent des approches revisitées tant sur la personnalité même de Fouché que sur son entourage, son époque, ses soutiens comme ses détracteurs (ô combien nombreux, ceux-là).
Beaucoup d'articles fournissent des informations jusqu'à présent inédites ce qui prouve qu'il y a encore des choses à trouver quand on met les mains dans le cambouis de la recherche. Avec ce Dictionnaire qui s'impose déjà comme une incontournable référence, bien des éclairages viennent "actualiser" Joseph Fouché, écornant quelque peu la "légende noire" qui s'attache à ce personnage hors du commun qui demeure pourtant complexe à bien des égards et qui, en dépit de tant d'archives et de témoignages parvenus jusqu'à nous, conserve toujours une part d'ombre propice à toutes les hypothèses et à tous les fantasmes.
**********